Homélie pour le 26e dimanche ordinaire
Abbaye Notre-Dame des Neiges, 28 septembre 2025
Version audio :
Les lectures de ce dimanche sont d’une importance « éternelle » ! La conclusion à laquelle mène la parabole que Jésus raconte nous le dit. Voici cette conclusion : la mort n’existe pas ! C’est seulement la vie terrestre qui s’achève, l’aspect terrestre de notre vie qui s’achève. La mort est une porte. En amont de la vie éternelle se trouve donc notre vie terrestre. Ces deux formes de la même vie sont intimement liées. L’une prépare l’autre. Mais jusque-là il n’y a rien de très nouveau, rien que ne nous sachions déjà probablement. Pourtant l’évangile nous apprend quelque chose que nous ne voyons pas la plus part du temps.
Avez-vous remarqué qu’il n’est pas reproché au riche d’avoir fait bombance, ni de se vêtir de lin fin, ni d’être riche. Dans sa parabole, Jésus le mentionne comme une description, mais pas comme un reproche. Ce n’est pas non plus ce qu’il a fait qui pose réellement problème. Il ne nous est pas rapporté qu’il ait refusé quoique ce soit à personne qui le lui ait demandé. Ce qui lui est reproché c’est une omission. Il n’a pas vu. Il n’a tout simplement pas vu. Il n’a dramatiquement pas vu. Il n’a même pas fait exprès. S’il n’a rien fait de mal, il a omis de faire quelque chose de bien. Ses affaires étaient sans doute florissantes, il était probablement fréquenté par des personnages importants. Il est bien possible qu’il bénissait Dieu pour sa réussite humaine. Seulement voilà. La vie de ce riche était si riche qu’il n’a pas vu Lazare. Sa vie était si riche, si trépidante, si excitante, qu’il ne pouvait pas voir Lazare.
Mais alors, direz-vous, quelle peut bien être sa culpabilité ? S’il ne pouvait pas voir Lazare, comment aurait-il pu lui venir en aide ? Écoutons la suite.
L’un et l’autre moururent. Cela arrive à des gens très bien de mourir. Et même à des pauvres, même si on en parle moins. Or nous apprenons quelque chose de très curieux. Ce n’est qu’après avoir quitté son corps que le riche put enfin voir Lazare. Ce fait nous est raconté d’une manière bien précise, à savoir de la bouche même du riche. En effet, s’adressant à Abraham, il dit : « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue ». Il reconnaît donc très bien Lazare. Il reconnaît celui qu’il ignorait durant sa vie terrestre. Voilà sa culpabilité. Il avait donc bien vu Lazare, peut-être même s’était-il désolé, durant sa vie terrestre, de la situation de Lazare. Peut-être s’était-il demandé comment Dieu avait pu permettre une telle pauvreté pour une de ses créatures ! (Ce sont souvent des réactions que nous entendons n’est-ce pas ? « Comment Dieu permet-il cela ?). Mais il ne s’était nullement tourmenté du désastre de la vie de Lazare. Il n’avait tout simplement rien fait pour essayer de l’en soulager ! Il n’avait pas compris que la chair de Lazare, c’était aussi sa propre chair, et qu’il était concerné par la pauvreté de son frère pauvre !
Répondons maintenant à la question « comment Dieu a-t-il permis cela ? ». N’aurait-Il pas dû intervenir ? L’a-t-Il seulement fait ? « Lazare », en hébreu « El ʿazar », signifie Dieu pourvoit ou Dieu secours. Dieu avait bel et bien secouru Lazare. Comment ? En le déposant à la porte du riche. Mais le riche n’a dramatiquement pas compris qu’il était responsable de Lazare. Il n’a pas compris que sa mission était de venir en aide à son frère pauvre. Et pourtant l’Écriture – c’est à dire Moïse et les prophètes – l’avait fait savoir par la bouche d’Amos notamment, comme nous l’avons entendu dans la première lecture.
Tout cela est d’une importance éternelle, comme je l’ai dit. Car la suite de l’évangile nous apprend une chose terrible. La toute petite distance qui séparait le riche de Lazare – peut-être quelques mètres ! – est devenue immense. Un peu comme deux droites qui se croisent dès le début de leur apparition mais dont la croissance et le développement ne cesse d’augmenter leur écart ! Et cet écart est tel qu’il n’est plus possible qu’elles se rejoignent à nouveau. J’imagine que vous n’avez pas besoin d’un dessin…
Combien de Lazare croisons-nous chaque jour ? Nous n’avons peut-être pas de pauvres qui gisent à notre porte. Mais la mendicité n’est pas seulement celle de la nourriture. Elle est aussi celle du sourire, de l’attention, du regard, de la douceur. Combien de sourire nous sont mendiés chaque jour ? Combien de regards bienveillants nous sont possibles chaque jour ? Combien de fois sommes-nous si impliqués dans notre travail ou notre mission, que nous ne voyons pas notre frère en détresse ? Un simple regard, un simple mot peuvent redonner la vie !
À Caïn qui venait d’assassiner son frère Dieu demanda : « Où est ton frère Abel ». Et Caïn répondit : « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? » Le Seigneur reprit : « Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi ! » (Gn 4, 10). Dans son encyclique Evangelium vitae de 1995, au n°8, saint Jean-Paul II écrivait à ce sujet : (…) dans tout homicide est violée la parenté « spirituelle » qui réunit les hommes en une seule grande famille, tous participant du même bien unique fondamental : une égale dignité personnelle. Oui, nous sommes responsables de notre frère. Ne le laissons pas mourir d’une faim que nous avons la possibilité d’assouvir. Peut-être simplement la faim d’un regard d’amour. Il pourrait en aller de notre éternité !
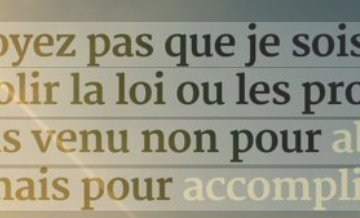


0 commentaire